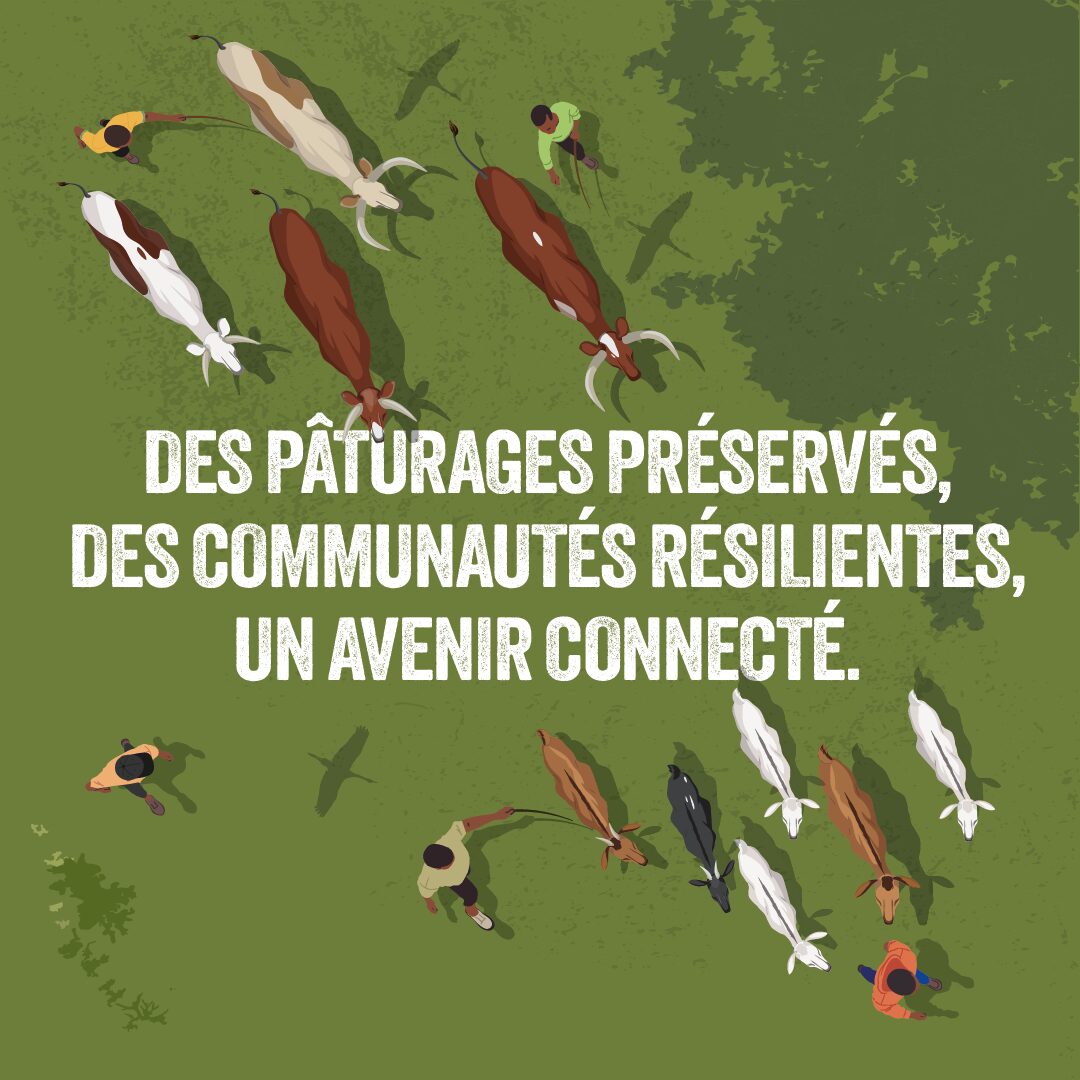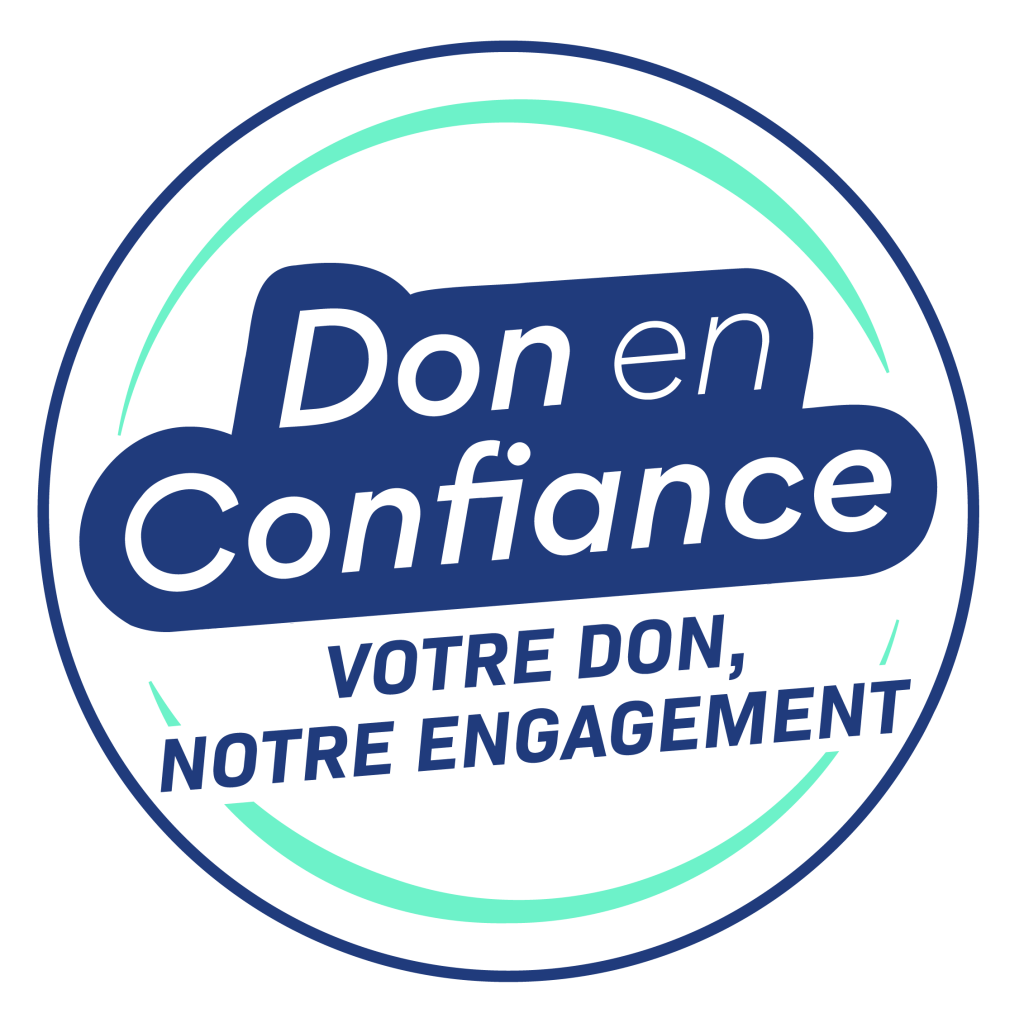« Une fois qu’ils auront commencé à exploiter les mines, nous n’aurons pratiquement plus rien. La terre cessera de produire et nous n’aurons plus de source d’eau. Il y aura des conflits. » Ce cri du cœur d’un habitant du Páramo, en Équateur, résume l’urgence de la situation.
Un écosystème vital…
Dans les hauteurs des Andes équatoriennes, entre 3 000 et 4 500 mètres d’altitude, s’étend le Páramo. Ce vaste écosystème battu par le vent et doté d’un climat singulier est une réserve de biodiversité et une véritable éponge, qui alimente en eau les villes et les territoires du pays.
Les peuples autochtones ont été forcés de s’y installer il y a des générations, quand les conquistadors espagnols sont arrivés pour coloniser leurs terres. Ils en connaissent encore l’importance vitale pour perpétuer la vie et nouent avec ce territoire une relation intime et sacrée.
Pour les populations indigènes des Andes, notamment les populations Kichwa, le Páramo est un véritable espace de vie, un être vivant avec lequel on entretient une relation spirituelle. « C’est peut-être un enseignement des anciens : aller souffler sur le “urku”, la montagne sacrée, la respecter. Nous croyons que la nature est plus forte que nous. »
À travers les générations, ces communautés ont développé des traditions et pratiques agricoles adaptées à ces altitudes extrêmes : choix de cultures et de variétés résistantes à de tels milieux, protection de zones fragiles de toute culture, voire d’animaux, gestion millimétrée de l’eau, etc. Le savoir
paysan s’y transmet oralement, des grands-parents aux parents et aux petits-enfants, enraciné dans le respect de la terre.
… menacé par l’extractivisme
Le Páramo est aujourd’hui menacé par l’industrie minière à grande échelle et l’agriculture intensive comme la floriculture. Ces activités perturbent profondément cet écosystème fragile. Elles exploitent sans retenue ses ressources en eau, s’accaparent des terres appartenant majoritairement aux communautés locales, et méprisent les règles traditionnelles de gestion et de protection de cet environnement.
Alors que les populations rurales comme urbaines dépendent de l’eau du Páramo, les décisions qui engagent son avenir sont souvent prises sans les communautés qui l’habitent et le défendent depuis des siècles. « Beaucoup de gens ne se rendent pas compte de l’importance du Páramo, surtout en ville. Mais si nous cessons d’en prendre soin, il n’y aura plus de vie », résume une habitante.
Soutenir les communautés : Urku Ñan ou « le chemin de la montagne »
Face à cette urgence, AVSF agit en partenariat avec les organisations locales grâce au projet Urku Ñan. Cette initiative vise à reconnaître et renforcer le rôle des communautés andines dans la préservation du Páramo et la gestion durable de leurs territoires.
En partenariat avec ECUARUNARI (Fédération des peuples et nationalités kichwa des Andes équatoriennes), l’équipe du projet a commencé par réaliser un inventaire participatif des pratiques communautaires, en s’appuyant sur les savoirs locaux. Sur cette base, les organisations indigènes ont
engagé un travail de réflexion pour analyser les nouvelles menaces et construire une réponse collective. Des équipes de recherche interculturelle, composées de techniciens et de représentants des communautés, mènent ce travail sur le terrain.
Urku Ñan met également l’accent sur la participation active des femmes et des jeunes, dans les décisions qui concernent leurs territoires. Enfin, il contribue à créer un espace de dialogue entre les peuples autochtones, l’État et les usagers de l’eau – agriculteurs, villes, industries – afin de poser les bases d’un nouveau pacte social autour de la gestion des prairies d’altitude.
Préserver le Páramo, c’est préserver une ressource vitale, un héritage culturel, et un modèle de cohabitation respectueux du vivant. « Nous sommes tous le Páramo. Nous devons tous et toutes comprendre son importance et comment en prendre soin. »
Face aux menaces extractives, le Páramo ne peut se défendre seul. Avec les communautés qui l’habitent et en prennent soin depuis toujours, il peut redevenir ce qu’il a toujours été : un sanctuaire de vie à protéger. Encore faut-il l’écouter.