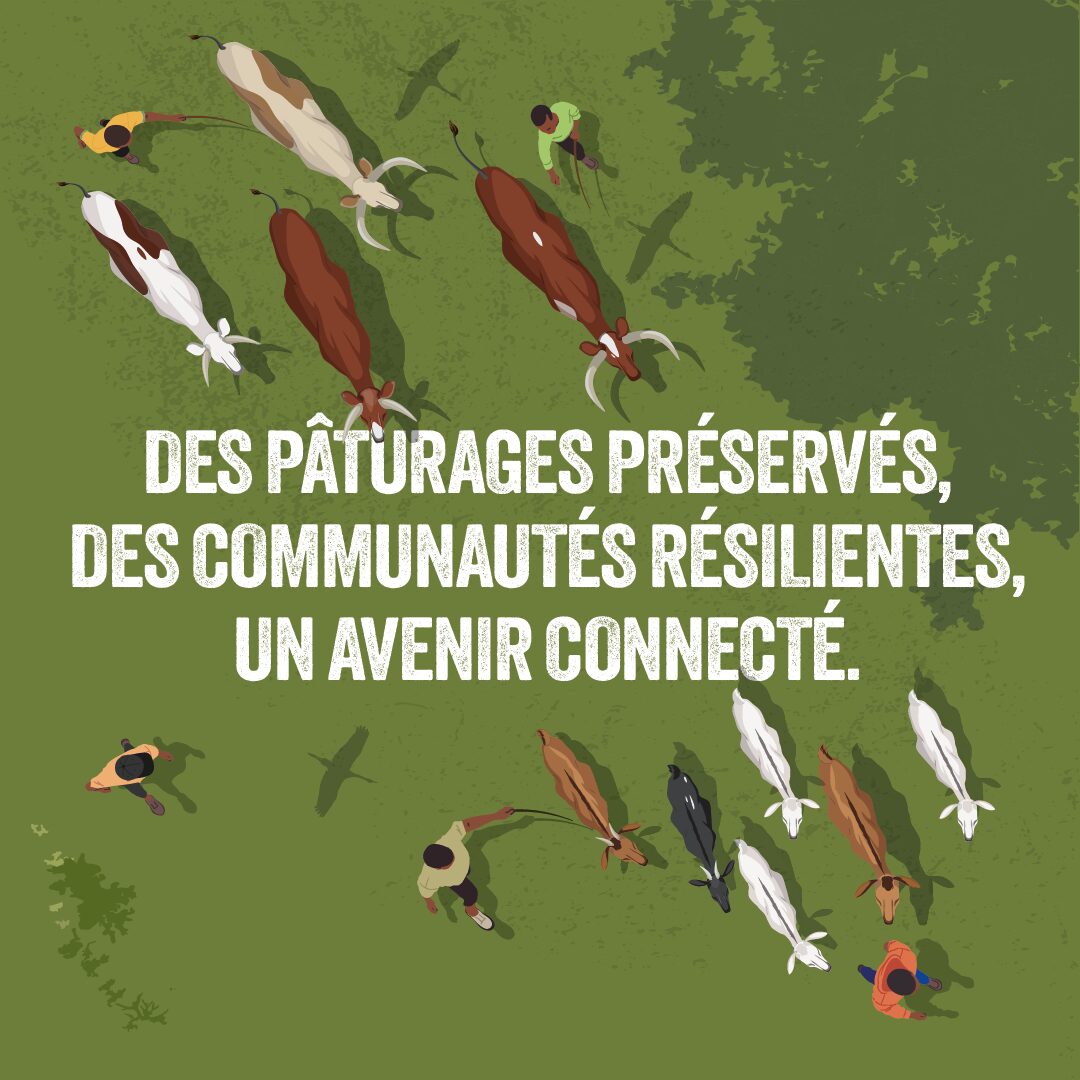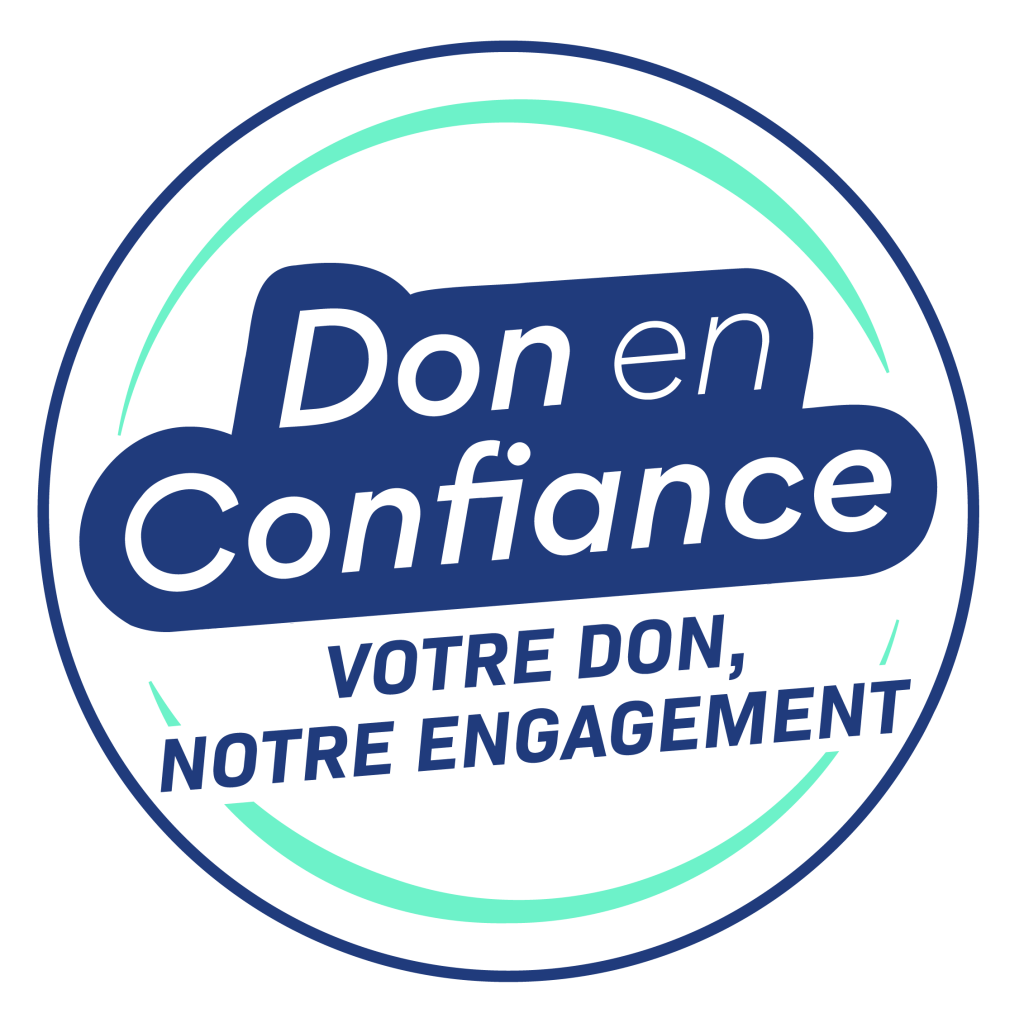Cacao, hévéa, noix de cajou… En Côte d’Ivoire, les cultures d’export nourrissent les marchés locaux, mais pas les familles. Avec le projet AVAL, AVSF soutient les paysans et paysannes pour garantir une alimentation saine et accessible à la population locale.
La Côte d’Ivoire compte parmi les plus grandes puissances agricoles d’Afrique de l’Ouest. Mais si les filières d’export comme le cacao y sont bien structurées, les productions vivrières – maraîchage, manioc, banane plantain – restent quant à elles peu productives et diversifiées. Les terres agricoles disparaissent sous la pression urbaine et l’utilisation massive d’intrants chimiques dégrade la santé des sols, des producteurs… et des consommateurs.
Bien se nourrir, un droit fondamental
Une alimentation variée, nutritive et sans danger est pourtant le premier remède pour rester en bonne santé. Or, quand les familles ne peuvent accéder qu’à des aliments pauvres en nutriments, trop chers ou contaminés par des pesticides, les risques de malnutrition, de maladies chroniques et de vulnérabilité s’accroissent. Entre 2020 et 2022, près d’un Ivoirien sur deux (44,2 %) était en situation d’insécurité alimentaire grave ou modérée.
Face à ce besoin crucial d’améliorer la sécurité alimentaire des familles, AVSF et Agrisud ont lancé le projet AVAL, dans le district autonome d’Abidjan et celui des Lagunes, une zone qui concentre 30% de la population ivoirienne.
Produire et commercialiser des produits diversifiés
L’ambition du projet AVAL est de permettre aux familles paysannes de produire et de commercialiser des aliments diversifiés, sains, et de le rendre accessibles pour garantir aux consommateurs une meilleure santé.
Concrètement, le projet accompagne des exploitations familiales de petite taille, souvent entre un demi-hectare et cinq hectares, qui vendent leurs récoltes jusqu’à Abidjan. Ces familles, qui ne sont la plupart du temps pas propriétaires de leurs terres, restent dépendantes d’intermédiaires pour vendre leurs produits, et des fluctuations de prix. AVAL les aide à mieux s’organiser, à se regrouper en coopératives, à trouver de nouveaux débouchés et à se former à des techniques agroécologiques adaptées pour réduire le recours aux intrants chimiques.
L’exemple de la coopérative Provig
À Dabou, la coopérative PROVIG, créée en 2020, réunit 151 maraîchers et producteurs de manioc. En quelques mois, grâce au projet AVAL, ses membres ont suivi des formations en gestion coopérative, en production de semences paysannes et ont même créé leur première biofabrique lors d’un atelier qui a réuni dix-sept producteurs et productrices pendant trois jours. L’objectif ? Produire et fournir des engrais et bio-pesticides naturels à tous les membres. Cela permettra de réduire les coûts de production et de protéger la santé des producteurs et des consommateurs.
« C’est plus économique de maîtriser l’agroécologie, parce qu’on utilise des choses que l’on peut trouver dans notre environnement, sans dépendre d’intrants achetés à l’extérieur. Depuis 2020, je suis passé à l’agroécologie, et je forme aussi des étudiants pour leur transmettre ce que j’ai appris », explique Marie-Paul Glamy, productrice et gérante de la biofabrique.
En Côte d’Ivoire, l’expérience de PROVIG et d’autres coopératives regroupant plus de 1 000 familles paysannes accompagnées par AVSF prouve que soutenir l’agriculture familiale, c’est agir directement pour la santé publique. Moins de pesticides dans les champs, plus de diversité dans les assiettes, et une alimentation saine et accessible aux familles urbaines comme rurales.