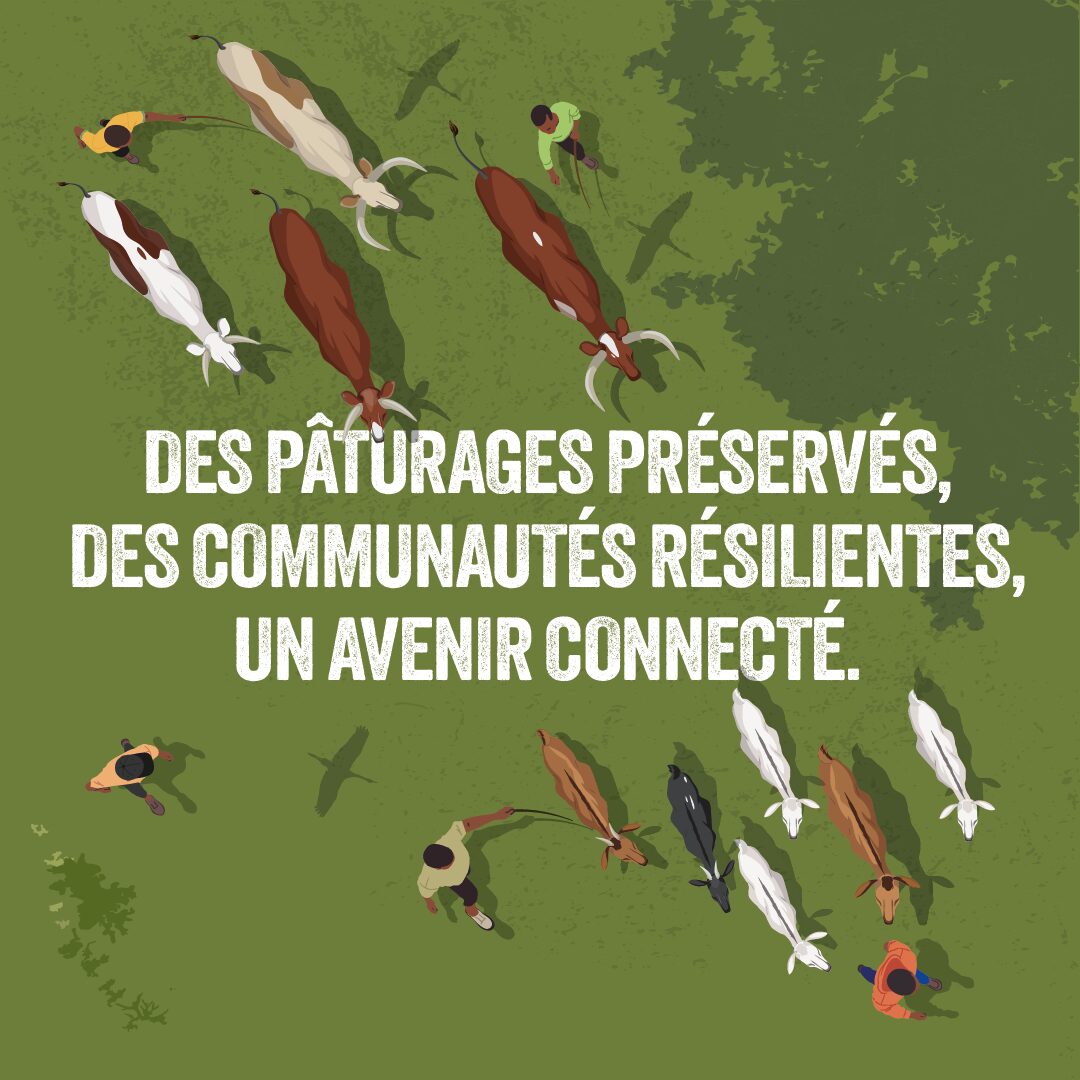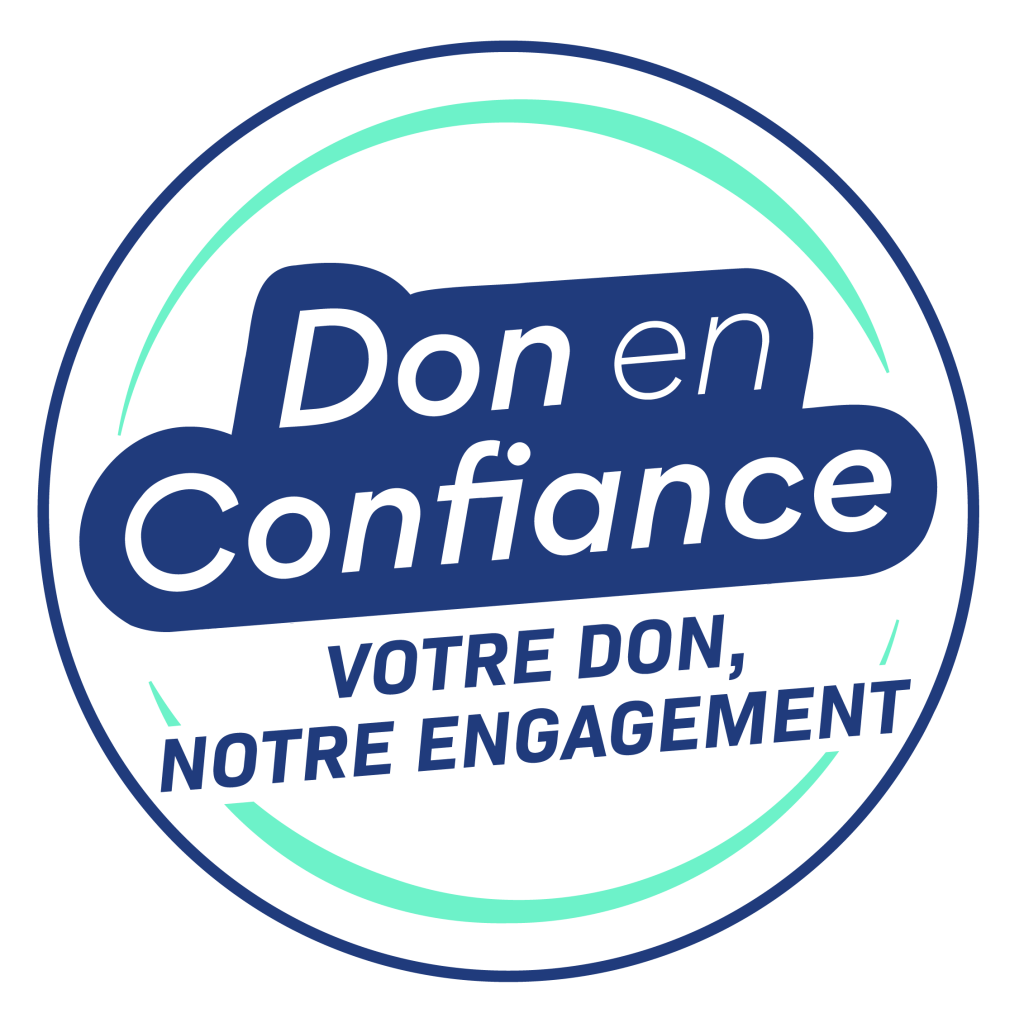En Afrique comme ailleurs, les pratiques vétérinaires traditionnelles incarnent un patrimoine vivant, souvent ignoré, parfois méprisé, mais toujours essentiel à la résilience des éleveurs-ses paysans-nes. AVSF se bat pour que cette mémoire ne disparaisse pas.
Pourquoi s’intéresser aux pratiques traditionnelles de santé animale ?
Les pratiques traditionnelles de santé animale, ou savoirs ethnovétérinaires, désignent un ensemble de
connaissances empiriques développées par les éleveurs pour diagnostiquer, prévenir et soigner les maladies de leurs animaux. Ces savoirs s’appuient principalement sur l’usage de plantes médicinales, mais aussi de substances naturelles comme le miel, la cendre ou l’argile. Ils sont le fruit d’une longue cohabitation entre les humains, les animaux et la nature.
Alors que l’accès aux services vétérinaires et à des médicaments de qualité reste limité dans de nombreuses zones rurales du Sud, les savoirs ethnovétérinaires apparaissent comme un levier essentiel pour la santé animale et la résilience des éleveurs-ses.
Mais aujourd’hui, ces connaissances traditionnelles sont menacées. Entre la diffusion planétaire de la médecine conventionnelle occidentale, l’attrait de la modernité, et la perte des savoirs traditionnels qui ne se transmettent souvent que par l’oral, ces derniers peuvent être abandonnés au profit des médicaments et techniques dits modernes. Pourtant, dans un monde confronté à la montée de l’antibiorésistance, à la pollution des écosystèmes et à l’accès inégal aux soins, ces savoirs constituent des alternatives durables, accessibles financièrement et localement, et respectueuses du vivant.
Recenser pour ne pas oublier
L’intérêt d’AVSF pour les pratiques traditionnelles de santé animale n’est pas récent. Depuis 2009, AVSF recense et valorise ces pratiques dans une démarche de santé intégrée. L’objectif n’est pas de les opposer à la médecine dite moderne, mais d’instaurer un dialogue entre les savoirs. Restaurer l’usage des soins traditionnels, quand leur efficacité et leur innocuité sont avérées, permet de réduire la dépendance à des médicaments coûteux, parfois contrefaits, de limiter les résidus dans l’alimentation et d’encourager des pratiques agroécologiques plus autonomes.
Mais cette valorisation implique prudence et rigueur : identifier les plantes, en mesurer les effets et l’efficacité, garantir leur durabilité écologique et la préservation d’espèces en danger, etc.
Au Sénégal, dans le département de Vélingara, AVSF a mené une enquête de terrain auprès de plus de 100 éleveurs-ses et tradipraticiens-nes. Face à des maladies endémiques (fièvre aphteuse, pasteurellose, peste des petits ruminants, variole aviaire, trypanosomose…), ces communautés disposent d’un savoir foisonnant : 146 plantes et 50 autres substances naturelles sont mobilisées pour soigner ou prévenir, stimuler la lactation ou repousser les parasites.
Ce savoir local reste vivace, mais fragile. Il pallie l’absence de services vétérinaires accessibles, tout en étant menacé d’oubli. Dès 2026, AVSF prévoit de tester l’efficacité de certaines de ces pratiques dans le cadre d’une deuxième phase du projet Thiellal, comme cela a déjà été fait en Éthiopie ou en Colombie. Une manière de croiser science et tradition pour bâtir une médecine vétérinaire réellement au service des éleveurs et du vivant.
Enquête sur les pratiques ethnovétérinaires en Casamance
- 146 plantes médicinales répertoriées, dont le baobab, le caïlcédrat, les lianes comme le Cissus populnea, le tabac, la pomme d’amour…
- 50 autres substances naturelles utilisées, dont le sel, le charbon, l’argile, les sables de rizière, le lait, le miel, etc.
- 32 maladies animales recensées
- 4 communes enquêtées : Ouassadou, Pakour, Paroumba, Linkéring